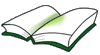BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'éditeur
Larousse |
Documents disponibles chez cet éditeur


 Affiner la recherche Interroger des sources externes
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : L'architecture moderne : Histoire / Principaux courants / Grandes Figures Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Bony Editeur : Larousse Année de publication : 2012 Importance : 239p Format : 25x14.5 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-03-587641-6 Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Index. décimale : 724 Architecture, 1400- Résumé : Un guide pour découvrir le patrimoine architectural d’hier à aujourd’hui_x000D_ L'architecture moderne : Histoire / Principaux courants / Grandes Figures [texte imprimé] / Anne Bony . - France : Larousse, 2012 . - 239p ; 25x14.5 cm.
ISBN : 978-2-03-587641-6
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Index. décimale : 724 Architecture, 1400- Résumé : Un guide pour découvrir le patrimoine architectural d’hier à aujourd’hui_x000D_ Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13/212354 L/724.013 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt 13/212355 L/724.013 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Disponible 13/212356 L/724.013 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Disponible
Titre : Dictionnaire des concepts philosophiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel Blay, Auteur Editeur : Larousse Année de publication : 9 Jan. 2013 Importance : 812 pages Présentation : 942 g Format : 14.2 x 3.8 x 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-03-585007-2 Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Index. décimale : 103 Dictionnaires, encyclopédies, concordances Résumé : Ce dictionnaire présente de manière ordonnée et pédagogique la base de ce que doivent maîtriser l’étudiant et l’enseignant en philosophie. 1 000 entrées classées par ordre alphabétique mettent ainsi en avant : - les concepts importants de la philosophie : autrui, conscience, désir, égalité, existence, nature, perception, réel, … - les grands courants philosophiques : essentialisme, évolutionnisme, perspectivisme, phénoménologie, positivisme, pragmatisme, relativisme, … - les philosophes qui ont marqué l’histoire de la pensée : Aristote, Hegel, Heidegger, Kant, Nietzsche, Platon, … Dictionnaire des concepts philosophiques [texte imprimé] / Michel Blay, Auteur . - France : Larousse, 9 Jan. 2013 . - 812 pages : 942 g ; 14.2 x 3.8 x 21 cm.
ISBN : 978-2-03-585007-2
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Index. décimale : 103 Dictionnaires, encyclopédies, concordances Résumé : Ce dictionnaire présente de manière ordonnée et pédagogique la base de ce que doivent maîtriser l’étudiant et l’enseignant en philosophie. 1 000 entrées classées par ordre alphabétique mettent ainsi en avant : - les concepts importants de la philosophie : autrui, conscience, désir, égalité, existence, nature, perception, réel, … - les grands courants philosophiques : essentialisme, évolutionnisme, perspectivisme, phénoménologie, positivisme, pragmatisme, relativisme, … - les philosophes qui ont marqué l’histoire de la pensée : Aristote, Hegel, Heidegger, Kant, Nietzsche, Platon, … Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15/250980 L/103.002 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt
Titre : Dictionnaire Français - arabe - Larousse 45000 mots : 45000 mots Type de document : texte imprimé Auteurs : Collectif Editeur : Larousse Année de publication : 2012 Importance : 640 p Format : 18×11 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-03-591581-8 Résumé : 45 000 mots,expressions et traductions
Tout le vocabulaire courant et actuel
Une présentation claire et aérée
Un grand nombre d’exemples pour repérer facilement la bonne traduction et connaître le contexte de chaque sens
De nombreuses aides pédagogiques sous forme d’encadrés :
Des encadrés thématiques de vocabulaire ou sur les difficultés linguistiques
Des encadrés d’expressions usuelles permettant aux utilisateurs de s’exprimer dans certaines situations
Des encadrés grammaticaux détaillés adressés spécialement aux apprenants francophones
Des notes culturelles et de civilisation
Un précis grammatical et les conjugaisons pour vérifier et approfondir ses connaissancesDictionnaire Français - arabe - Larousse 45000 mots : 45000 mots [texte imprimé] / Collectif . - France : Larousse, 2012 . - 640 p ; 18×11 cm.
ISBN : 978-2-03-591581-8
Résumé : 45 000 mots,expressions et traductions
Tout le vocabulaire courant et actuel
Une présentation claire et aérée
Un grand nombre d’exemples pour repérer facilement la bonne traduction et connaître le contexte de chaque sens
De nombreuses aides pédagogiques sous forme d’encadrés :
Des encadrés thématiques de vocabulaire ou sur les difficultés linguistiques
Des encadrés d’expressions usuelles permettant aux utilisateurs de s’exprimer dans certaines situations
Des encadrés grammaticaux détaillés adressés spécialement aux apprenants francophones
Des notes culturelles et de civilisation
Un précis grammatical et les conjugaisons pour vérifier et approfondir ses connaissancesRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19/319507 A/413.516 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt 19/319508 L/413.516 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Disponible
Titre : Dictionnaire de la sociologie Type de document : texte imprimé Auteurs : Boudon, Raymond Editeur : Larousse Année de publication : 2018 Importance : 510 p Format : 19×13 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-03-595477-0 Résumé : Ce dictionnaire, largement refondu et augmenté, constitue un moyen d’accès rapide et efficace au savoir sociologique. Près de 400 articles présentent les concepts, les orientations, les domaines de recherche les plus variés et les plus récents de la sociologie. Ainsi, au fil des pages, c’est un panorama des problèmes sociaux contemporains qui est brossé, de l’exclusion à la mondialisation, des incivilités à la violence collective.
L’ouvrage comprend également une soixantaine de monographies sur les principaux auteurs français et étrangers de la discipline. Il est complété par une abondante bibliographie.
Une synthèse claire et un panorama complet des grandes notions de la sociologie.Dictionnaire de la sociologie [texte imprimé] / Boudon, Raymond . - France : Larousse, 2018 . - 510 p ; 19×13 cm.
ISBN : 978-2-03-595477-0
Résumé : Ce dictionnaire, largement refondu et augmenté, constitue un moyen d’accès rapide et efficace au savoir sociologique. Près de 400 articles présentent les concepts, les orientations, les domaines de recherche les plus variés et les plus récents de la sociologie. Ainsi, au fil des pages, c’est un panorama des problèmes sociaux contemporains qui est brossé, de l’exclusion à la mondialisation, des incivilités à la violence collective.
L’ouvrage comprend également une soixantaine de monographies sur les principaux auteurs français et étrangers de la discipline. Il est complété par une abondante bibliographie.
Une synthèse claire et un panorama complet des grandes notions de la sociologie.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19/319657 L/413.517 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Disponible
Titre : Géopolitique : la longue histoire d'aujourd'hui Type de document : texte imprimé Auteurs : Lacoste Yves, Auteur Editeur : Larousse Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Index. décimale : 320 Science politique (politique et gouvernement) Géopolitique : la longue histoire d'aujourd'hui [texte imprimé] / Lacoste Yves, Auteur . - France : Larousse, [s.d.].
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Index. décimale : 320 Science politique (politique et gouvernement) Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13/200861 L/320.047 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink